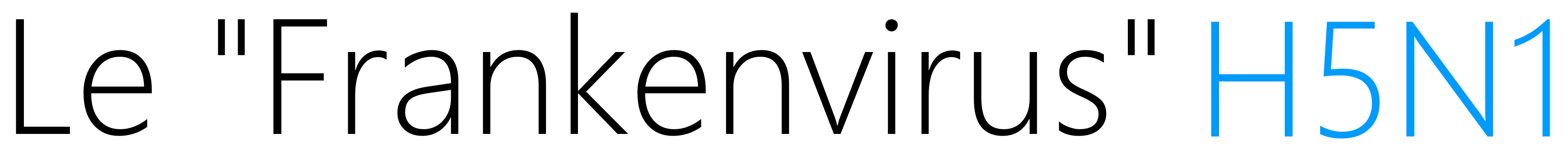Les dangers du bioterrorisme

Un usage militaire inenvisageable
Il suffit pour disqualifier un usage militaire de se pencher sur la nature d’une grippe. La transmission par voie aérosol garantit en effet que le virus se répandrait de manière pandémique et atteindrait sans distinction aucune un camp comme l’autre. Quand bien même était atteinte la transmission homme/homme, un virus grippal utilisé comme arme se révèle autodestructeur, du fait de la quasi-impossibilité de contenir la contagion à un espace ou à une population. A cela s’ajoute la rapidité de mutation du virus, qui rend quasi-impossible la création d’un vaccin universel. Si l’existence de l’armement bactériologique est certaine, et que la question de la prévenance d’attaques grippales étudiée, la production d’armes de ce type n’est sans doute ni viable ni envisagé par les armées nationales.
Le bioterrorisme, un risque?
Cependant, une logique de conflit différente peut mener des groupes considérés comme terroristes à considérer l’usage de telles armes. Les cas d’attaques bactériologiques aveugles de ces organisations existent, bien qu’il ne s’agisse pas d’un moyen d’action particulièrement répandu. On peut citer la contamination d’une dizaine de restaurants en Oregon avec la bactérie de la salmonelle (causant entre autre la fièvre typhoïde) en 1984; la tentative par la secte japonaise Aum d’obtenir un échantillon du virus Ebola par un voyage en Afrique en 1992. Force est de constater que ces entreprises restent maladroites et d’étendue très limitées; ce genre de groupes manquant cruellement des moyens techniques nécessaires pour permet le recueillement, la synthétisation ou le gain de fonction sur des souches virales.
La sécurité en laboratoire
Cependant ce risque de bioterrorisme est pris au sérieux par les autorités, et les circulations administratives des laboratoires abordent depuis le début des années 2000 la question des éventuelles attaques terroristes. Ce sujet amène à un point précis de la critique émise sur le déroulement des recherches des professeurs Yoshihiro Kawaoka et Ron Fouchier. En effet fut pointé le niveau de sécurité des laboratoires, jugés insuffisants. Classés au niveau Biosafety Level Level 3, les critiques estiment que monter au grade maximal, le niveau 4, était nécessaire. Si le Biosafety Level 3 semble adapté à la manipulation de souche virale (du fait de l’imposition d’un contrôle stricte des risques de transmission aérosol passant notamment par un système de ventilation individuel via des combinaisons scellées). Mais le niveau 4 inclue la protection en termes de sécurité « policière » en imposant la présence de gardes armés, donc une prise en compte de la possibilité terroriste.
La question de la circulation des recherches
Mais au-delà de l’intrusion en laboratoire, le risque passe également par le trafic. Ceci rejoint donc la question de la diffusion des recherches et l’encadrement des communications des chercheurs. Le suivi d’un tel phénomène est, du fait de sa nature illicite, impossible à suivre parfaitement. Un durcissement de l’encadrement sécuritaire des laboratoires est à prévoir au vue de l’actualité: un article de Foreign Policy publié le 29 aout 2014 a communiqué à partir d’un ordinateur portable d’un djihadiste de l’État Islamique que des recherches visant à utiliser le virus de la peste bubonique dans une optique militaire avait été entreprise par l’organisation terroriste, visant la contamination par voies aérosols de lieux publics (métros…) dans le cadre d’attentats-suicides.
A partir de la question du bioterrorisme, on peut préciser que la question « faut-il effectuer les recherches » fut précédée par la question de la diffusion des résultats